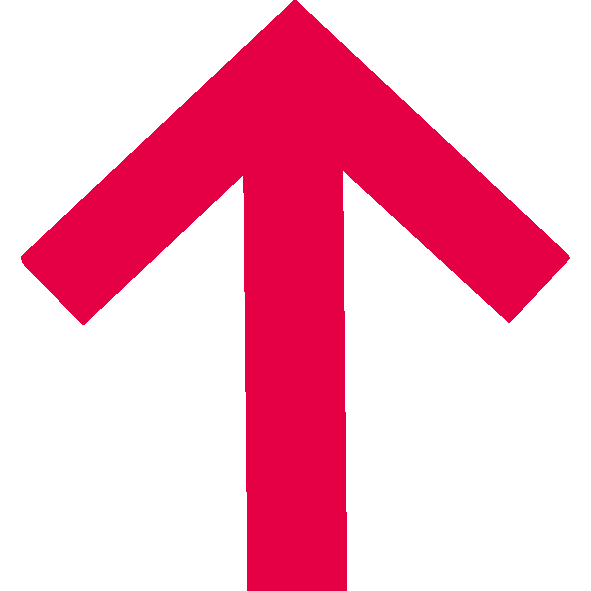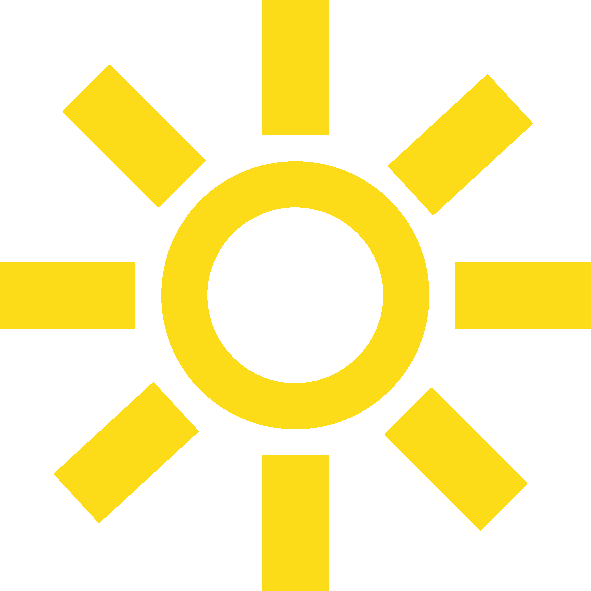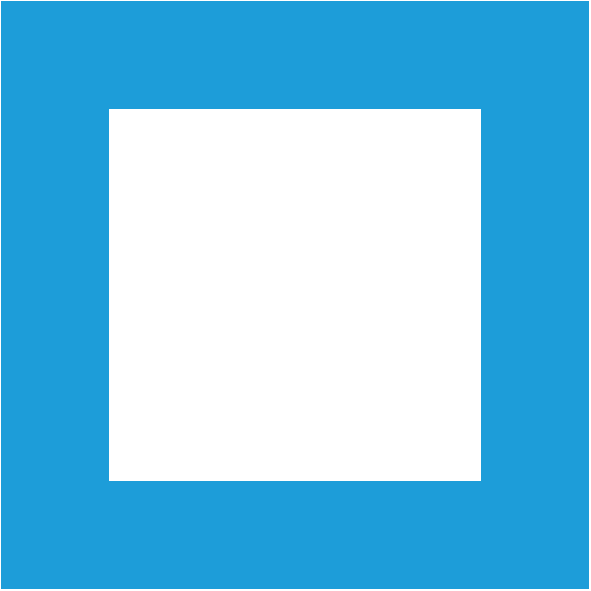Dérouler un accompagnement réussi
Couleurs des managers dans leurs accompagnements
|
|
Talents et opportunités |
Freins et limites possibles |
|
Tendance rouge
|
Style directif qui s’applique bien aux personnes qui savent faire et ont besoin d’autonomie Donnant peu d’explications, |
Ne prend pas le temps Pense qu’il ira plus vite à faire lui-même. Impatient, il attend un retour sur investissement très court. |
|
Tendance jaune
|
Utilisera ces temps d’apprentissages pour créer des liens et se faire apprécier. Relation de confiance naturelle, propice Favorise l’autonomie |
Risque d’être flou Fait confiance naturellement donc risque d’oublier la validation |
|
Tendance verte
|
Patience, esprit positif, orienté vers les hommes, méthodique, il saura consacrer du temps pour développer ses |
Peut materner, coucouner un peu trop et brider l’apprentissage personnel qui s’acquiert aussi par l’expérience sur le tas |
|
Tendance bleue
|
Saura prendre du temps, Formalisera ses accompagnements et en mesura les effets |
Pointilleux sur la méthode qu’il a définie, il peut couper les ailes de la créativité et de l’envie. Très exigeant, il aura du mal à féliciter, s’attardant facilement sur la procédure et moins sur la motivation et la réussite finale. |
Les attitudes du manager-coach : fondamentaux
« On ne peut pas motiver un individu mais seulement créer
les conditions dans lesquelles il va se motiver lui-même. »
(Deci & Ryan) inspiré de Galilée
Muhammad Yunus, inventeur pakistanais du microcrédit permet à 210 millions de familles de retrouver le chemin de l’autonomie en développant une activité indépendante (microcommerce, artisanat ou agriculture, pêche…). Il insiste avant tout sur le fait que chaque individu, même le plus inculte ou le plus pauvre, possède en lui suffisamment de créativité pour imaginer comment résoudre par lui-même ses difficultés. C’est en quelques sortes comme si par instant vous mettiez votre casquette de manager, visière vers l’avant pour donner la vision et les objectifs, mais qu’à d’autres moments, vous la touniez vers l’arrière pour laisser votre collaborateur analyser et résoudre ses propres difficultés. Comme vous vous en doutez, chaque manager peut adopter cette double posture, mais à condition de refreiner quelques tendances naturelles…
La posture du manager-coach s’appuie sur ces notions :
- Chaque individu est naturellement créatif et dispose de ressources personnelles. Il est essentiel de croire sincèrement en son champion
- Le coaché est moteur de son propre développement dont il est responsable. Le manager doit questionner, écouter et encourager les initiatives
- Le désir de progresser est le point de départ des changements.
- L’attitude de soutien nécessite de créer un bon climat relationnel mais ne pas en abuser (maternage).
- L’attitude de conseil peut ponctuellement faire réagir ou fournir des éléments de réflexion.
- Les attitudes de jugement et d’interprétation sont à proscrire (elles bloquent et biaisent l’entretien).
■ La préparation
L’autodiagnostic
La phase de préparation est essentielle puisque le coaching repose sur une totale implication du coaché qui est acteur de son changement. Dans cette même mesure, la préparation à un coaching doit apporter au collaborateur un outil méthodologique lui permettant de faire un point objectif sur sa situation. Développer son aptitude de recul et de remise en cause est un des premiers objectifs du coaching.
L’autodiagnostic peut se faire à partir d’un questionnaire couvrant les grandes fonctions de son métier (aspects techniques), ainsi que les comportements nécessaires à l’obtention des résultats (aspects comportementaux).
Réflexion sur les attentes
La démarche de coaching a été initialisée sur des espoirs de progression, voire de solutions. À ce stade, il est important que le coaché fasse un point sur sa situation et les zones d’imperfection qu’elle comporte, afin de les transformer en désir de solution (passer d’un besoin latent à un besoin explicite).
Ces attentes doivent ensuite être priorisées selon deux critères :
- Les améliorations qui m’apporteraient le plus grand bénéfice (pour bien décrire l’état désiré, il faudra décrire précisément ce qu’apporteraient de nouvelles compétences en termes d’organisation, de relation vente, d’image, de développement personnel…).
- Les sujets qui semblent les plus faciles à travailler : quelles sont les compétences mobilisables, que me faudrait-il pour progresser en ce domaine (benchmark avec d’autres collègues, sorties terrain avec mon patron, formations spécifiques, outils) ?
Le diagnostic croisé
Les résultats ainsi obtenus ne sont pas le strict reflet de la réalité. Ils ne sont que la représentation que le collaborateur a de lui-même. Il est donc intéressant de comparer ces résultats aux témoignages d’autres personnes de l’entourage. Il va sans dire que cette comparaison ne se fera qu’avec l’accord préalable du coaché qui aura compris l’intérêt de cet angle d’analyse. Le diagnostic croisé peut être fait avec l’ensemble des membres de l’équipe, le supérieur hiérarchique ou des membres d’autres équipes qui travaillent en interrelations.
■ L’échange
Il est capital de bien comprendre les attentes et enjeux. Ces attentes sont pour partie formulées explicitement, c’est la partie émergée de l’iceberg. Pour découvrir la partie immergée, il faudra, en s’appuyant sur une technique de questionnement appropriée, écouter les réponses faites en verbal mais aussi en non-verbal (attitude, regard, position des yeux, choix des mots, phrases non finies).
Le débriefing des forces et axes de progression doit initier un libre-échange à l’issue duquel le manager/coach et son collaborateur sont d’accord sur les points forts qui seront les points d’ancrage ainsi que sur les zones de progression.
Comparaison des diagnostics
L’analyse comparative permet par ailleurs de diagnostiquer la connaissance que la personne a d’elle-même ainsi que la façon dont les autres la perçoivent. De ces écarts naîtront des objectifs d’amélioration.
Fixation des objectifs
Cette étape doit aboutir au classement de thèmes prioritaires concertés. La situation étant maintenant claire aux yeux du coach et du coaché, il convient de fixer des objectifs. Ceux-ci doivent être clairement exprimés de manière quantifiable. Ils peuvent porter sur le quantitatif aussi bien que le qualitatif (v. méthode CAR décrite au chapitre 8).
La méthode CAR permet de fixer :
- C : comportements qui permettront l’amélioration.
- A : actions précises à déterminer.
- R : résultats escomptés.
■ L’accompagnement
Le manager doit consacrer du temps à accompagner sur le terrain, sur des sujets préalablement choisis. Or, on constate que c’est souvent la nécessité du business qui déclenche les accompagnements terrain (régler un litige, signer un contrat) et plus rarement un objectif pédagogique. Qu’il s’agisse d’un vendeur en négociation chez un client, d’un chargé d’affaires étudiant un dossier sensible, d’un téléacteur travaillant sur un plateau, d’un collaborateur dans un exercice de prise de parole en public, l’accompagnement s’impose. Le manager/coach doit si possible ne pas intervenir (et c’est là la plus grande difficulté, comment imaginer par exemple de laisser passer un contrat en ne restant qu’observateur ?).
Un entretien permettra d’évaluer la prestation (après une autoévaluation) et d’en tirer des axes d’amélioration.
■ L’évaluation
Cette étape ne doit pas être un jugement unilatéral du manager envers le collaborateur, mais un état des lieux partagé. Plus vous travaillerez à partir de critères et descriptifs précis, plus il sera facile de faire partager les faits par votre collaborateur. Si vous êtes amené à intégrer un grand nombre de jeunes et à faire un grand nombre de coachings, nous vous suggérons de construire votre propre grille d’évaluation.
À la fin de cette étape, le collaborateur doit savoir clairement :
– quels sont ses points forts ;
– ce qu’il doit faire progresser ;
– comment faire pour progresser.
Cela doit permettre aussi de verrouiller ses nouveaux savoir-faire et éviter un retour aux anciennes mauvaises habitudes. Cette évaluation pourra venir enrichir l’entretien d’évaluation annuel. Les champs de progression devront être accompagnés de moyens de progression (binôme, parrainage, formation, support du responsable, sorties terrain…).
Nous vous suggérons de laisser une trace écrite, même très succincte
(document présenté ci-après) qui permettra à votre collaborateur de se reporter à vos conseils pas à pas et à vous-même de faire le point la séance suivante.
Compte rendu du coaching du…Les points de forces : ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Les axes de progrès : – comportements : ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... – actions spécifiques à mener/échéances : ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... – résultats escomptés : ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... |
■ Suivi dans le temps
Les mauvaises habitudes reviennent au galop ! Il est important de fixer des rendez-vous intermédiaires permettant de valider les acquis. Cet accompagnement doit se faire tant que le savoir-faire n’est pas automatisé.
À VOUS DE JOUER !
Situation 1
Xavier R. dirige une équipe de douze commerciaux. Ses résultats sont bons, l’ambiance est bonne. Dans son équipe, Sébastien G. bénéficie d’un vrai leadership positif qui porte à lui seul 19 % des résultats de l’agence. En outre, celui-ci est évolutif et dispose déjà hors entreprise d’une expérience d’encadrement puisqu’il est dirigeant d’un club sportif.
C’est dans ce contexte que le DRH de l’entreprise demande aux directeurs d’agences s’ils ont dans leurs équipes des « promouvables » en vue de l’ouverture d’un poste de directeur d’agence. Xavier R. répond par la négative, ne voulant en aucun cas imaginer devoir se séparer d’un élément qui pèse près de 20 % de ses résultats.
Quelle est votre analyse de cette situation ?
Notre point de vue
En appliquant une stratégie à court terme Xavier R. risque gros :
– Sébastien G. peut apprendre l’ouverture du poste et vivre la position de Xavier R. comme une injustice (démotivation assurée) ;
– les autres commerciaux peuvent aussi être démotivés (d’appartenir à une agence où l’on n’évolue pas).
Le comportement optimal aurait été (après s’en être entretenu avec lui) de proposer la candidature de Sébastien tout en négociant le délai nécessaire au recrutement et à la formation de son successeur.
Ainsi Xavier, au-delà de la reconnaissance témoignée à son meilleur élément, aurait engendré une émulation de toute son équipe. Cela permettrait de compenser à moyen terme le manque à gagner de son départ et d’envisager quelques permutations de secteurs efficaces. Xavier aurait en outre renforcé son image de manager-promoteur.
Situation 2
Jacques S. vient d’accompagner Lætitia M. en clientèle.
Quelques morceaux choisis du débriefing :
« Tu n’as pas été bonne et si tu t’y prends toujours comme cela, tu n’es pas prête d’atteindre tes objectifs ! »
« Heureusement que j’ai repris la main car sinon, je pense que cette affaire aurait capoté ! »
« Voilà tout ce qui ne va pas (…) »
« Je vais te dire ce que tu dois faire (…) »
À l’issue du débriefing, Lætitia M. semble découragée. Pourtant, l’analyse de Jacques S. était juste et ses conseils avisés.
Quelle est votre analyse de la situation et quelles sont vos préconisations ?
Notre point de vue
Attention au piège du jugement de valeur (bien, pas bien, bon, mauvais…). Jacques S. devrait établir son débriefing sur le mode questionnement pour permettre à Lætitia de faire une autoanalyse. Par exemple :
« Comment as-tu vécu ton entretien ? »
« Quelle est ton analyse ? »
« Qu’as-tu obtenu comme informations ? »
« Que penses-tu de ton argumentation ? »
« Comment a réagi ton client lorsque… ? »
« Qu’est-ce qui a manqué selon toi à ta proposition ? »
« Quelle va être désormais ta stratégie ? »
Jacques S. devrait éviter une rafale de critiques et privilégier d’abord les points positifs pour lever les défenses de son interlocutrice.
On peut s’interroger sur l’opportunité de prendre la main lors d’un accompagnement et d’agir à la place du collaborateur. Tout dépend de l’enjeu, mais celui de se mettre dans les meilleures conditions de formation en prenant du recul n’est-il pas prioritaire ?